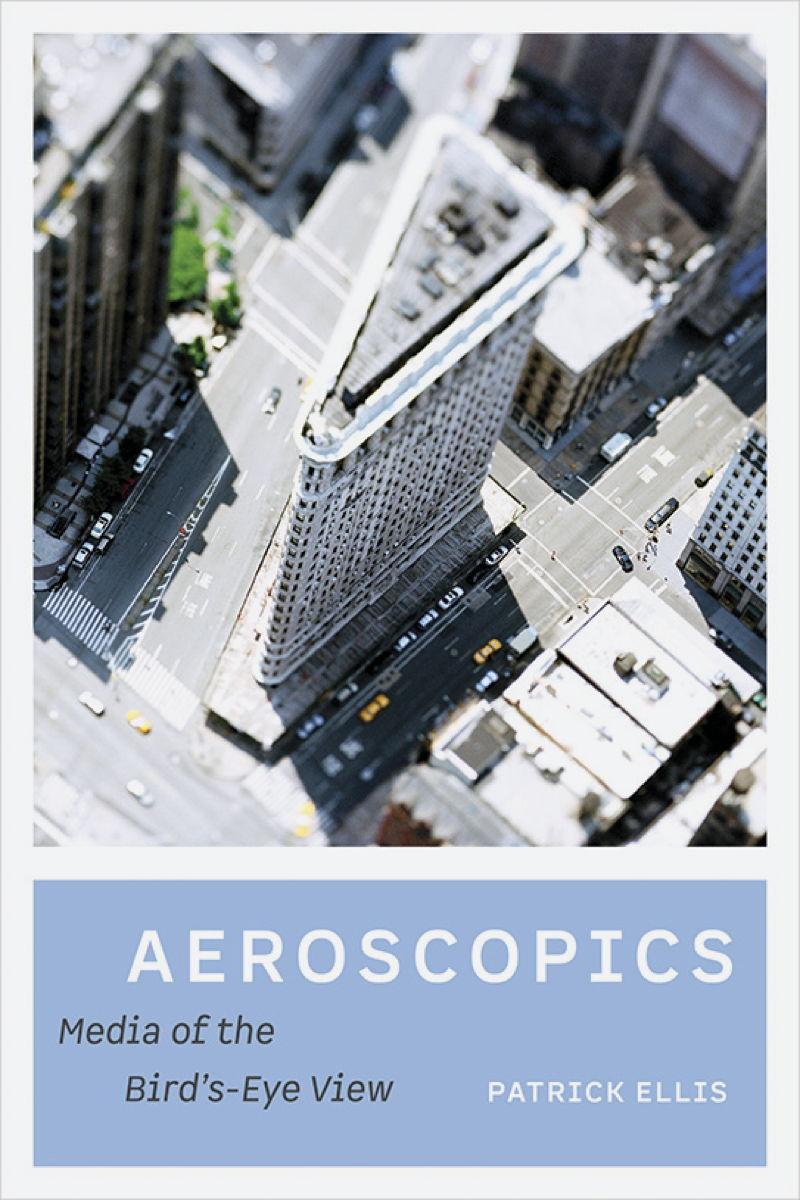
De nouvelles explorations de l’histoire de la photographie, du cinéma et des médias sont lancées depuis quelque temps sur l’axe de la hauteur, celui de l’étagement de l’espace, de l’élévation du point de vue et de l’envol des dispositifs de vision. De l’étude de Merrill Schleier sur l’architecture verticale des gratte-ciel au cinéma1 jusqu’à celle de Vanessa R. Schwartz sur l’esthétique propre à l’ère du jet2, tout porte à croire que l’espace aérien intéresse désormais l’archéologie des média, l’histoire du cinéma et les études visuelles. S’il vient confirmer cet élan vers les régions célestes, l’ouvrage de Patrick Ellis propose d’emblée d’en interroger l’une des notions cardinales, celle de « vue aérienne », pour mieux faire ressurgir la diversité de pratiques, d’espaces et d’expériences qu’elle recouvre. En se préoccupant précisément d’une modalité historique de la vision d’en haut, soit la « vue à vol d’oiseau », son enquête opte dès le départ pour une navigation à basse altitude, située à une hauteur comprise entre 200 et 400 pieds. L’avènement de l’aviation n’y constitue donc pas tant le moment d’essor de la vue aérienne que celui de son redéploiement, si bien qu’il marque le terminus ad quem de la période étudiée. Le défi principal de l’ouvrage semble ainsi tenir tout entier dans cette proposition initiale de renversement, appelant l’excavation de médias oubliés – comme le « panstéréorama » – ou la réévaluation d’objets plus familiers – tel le cinéma des premiers temps.
Revisitant d’abord l’histoire balisée du panorama sous l’angle inédit de la vue d’en haut, l’auteur suggère dans son premier chapitre de s’affranchir de la comparaison récurrente avec l’espace du panoptique et de se départir des connotations négatives – en particulier des suspicions de coercition – qu’elle fait peser sur ce média apparu à la fin du XVIIIe siècle. En retournant aux brevets d’invention et aux guides distribués au public, mais aussi en se rendant lui-même sur les lieux de panoramas sauvegardés en Amérique du Nord et en Europe, il s’attache plutôt à documenter la connexité historique des spectacles panoramiques avec un autre espace, celui de l’observatoire astronomique, avec lequel ils partagent des dispositifs de vision tels que le télescope. Au moment de leur fabrication, les panoramas de villes sont non seulement fondés sur un principe d’élévation du point de vue au-dessus de la cité suivant un angle de vision oblique, mais ils viennent aussi littéralement prendre appui sur des observatoires, comme dans le cas emblématique du Panorama of Edinburgh de Robert Barker (1789). À cette quête technique d’un point de vue surplombant correspond un mode de vision du spectacle panoramique qu’Ellis relie aussi à l’observatoire en le qualifiant d’« hybride » (p. 22), dans le sens où il se caractérise par une oscillation entre le tout et le particulier, l’ensemble et le détail, la perspective urbaine et la figure humaine.
Du panorama, le panstéréorama étudié au chapitre suivant retient le nom, qu’il complique cependant en lui ajoutant la notion de relief. Ce média volatilisé, qu’Ellis s’évertue à reconstituer à travers les guides et les récits de visites, hérite surtout du principe d’un embrassement total du paysage urbain grâce à un point de vue surplombant. Ici, l’impression de hauteur, voire de flottement dans les airs, n’est plus atteinte au moyen d’immenses toiles peintes encerclant les visiteurs, mais par des maquettes de villes détaillées à l’extrême autour desquelles le public est libre de circuler. En prenant soin de le distinguer du plan-relief, l’auteur vise à réinscrire le panstéréorama dans le contexte des « spectacles cartographiques» (p. 50) de la première moitié du XIXe siècle, où la vue d’en haut se prête moins à une fonction stratégique qu’à un divertissement visuel. Ce média procure ainsi l’illusion d’un voyage en ballon au-dessus d’une cité existante, mais rendue méconnaissable par la miniaturisation et l’« effet aérien » (p. 71) qui lui est associé. En même temps qu’elles multiplient les attractions basées sur des jeux d’échelle, les expositions universelles ont tendance à redéfinir la visée du panstéréorama, qui s’y fait plus volontiers rétrospectif ou prémonitoire. Dans la récupération des techniques de la maquette par le cinéma, l’auteur retrouve aussi des affinités évidentes entre des pratiques de miniaturisation de la ville et la recherche d’un point de vue aérien.
Si les spectacles panoramiques et leurs dérivés ont pu tenter de restituer la vue d’en haut, le cinéma semble avoir ajouté à l’illusion du vol un mal de l’air, une ivresse des hauteurs proche des effets plus ou moins indésirables du voyage aérien : vertige, nausée, sueur, etc.3 Mettant l’accent dans son troisième chapitre sur la réception, les réactions physiologiques et les usages médicaux du cinéma, Ellis repart d’un corpus de films connu sous le nom de phantom ride pour en interroger la composante aérienne avec un film tel que The Flying Train (1901). On imagine alors aisément de prochaines analyses se penchant sur les relations entre panorama, hauteur et mouvement au sein d’une « vue » Lumière comme Panorama pendant l’ascension de la tour Eiffel (1897). Cinéma et vertige font ainsi bon ménage dans le domaine du divertissement, où certains films misent explicitement sur la peur du vide et l’angoisse de la chute, mais l’auteur prouve en puisant dans l’histoire des sciences – option méthodologique qui fait aussi l’originalité de ce livre – qu’ils sont également reliés l’un à l’autre par des dispositifs utilitaires, développés par l’industrie aéronautique notamment. Du côté de l’attraction comme du côté de l’expérimentation, le cinéma rejoint une série de «machines à vertige» (p. 89) par le truchement desquelles la vue d’en haut et ses effets déstabilisants peuvent être appréhendés, sinon domestiqués, sans qu’il soit nécessaire de quitter le sol.
Dans la continuité de cette exploration d’une convergence entre hauteur et mouvement, Ellis se tourne ensuite vers l’architecture monumentale mais provisoire des expositions universelles, qui chacune à leur tour se sont dotées de perchoirs vertigineux. Moins connu sans doute que la tour Eiffel (Paris, 1889) et la grande roue de Ferris (Chicago, 1893), l’Aeroscope de l’exposition universelle de San Francisco (1915) est précisément conçu comme un poste d’observation mobile, combinant le point de vue en hauteur avec un mouvement ascensionnel. À la différence de ses devancières qui n’étaient pas non plus dépourvues de mouvement – l’ascenseur fut un élément remarqué de la nouvelle architecture de fer et de verre –, cette construction métallique suit une trajectoire sinueuse qui peut être interprétée moins en termes de domination visuelle de l’espace que comme une altération plaisante et ludique de la perspective, voire une perte de repères. En même temps qu’il propose une analyse fouillée de l’Aeroscope basée notamment sur le film Mabel and Fatty Visiting the World’s Fair at San Francisco (1915), ce quatrième chapitre revient sur le terme dérivé du nom de cette attraction qui donne son titre à l’ouvrage, de sorte à circonscrire la forme historique de la vue d’en haut examinée jusqu’ici.
Dans un ultime contre-pied, Ellis finit son enquête par une étude de la période d’émergence erratique de l’aviation où il s’intéresse moins aux nouvelles formes et significations de la vue aérienne qu’à la «vue d’en bas» (p. 116), c’est-à-dire le regard dirigé vers le ciel que suscite le surgissement d’une machine volante au-dessus des zones habitées. Avant d’être interprétée comme le présage funeste d’une attaque aérienne, une telle apparition est associée dans ses premiers temps aux notions de distraction, de surprise et de spectacle, situant le passage de l’avion dans une lignée d’attractions célestes. Réactivant la relation entre le concept de medium et l’élément aérien, l’auteur considère les manifestations aéronautiques parmi des pratiques culturelles visant à changer le ciel en écran. Il les relie aussi aux représentations d’encombrements aériens que l’on rencontre alors par exemple chez le pionnier de l’animation Émile Cohl dans le film En route (1910). Au gré d’un dernier croisement avec l’historiographie du cinéma – dont il alimente au passage l’un des plus vifs débats –, il rapproche finalement le mythe fondateur d’un public effrayé par la projection d’un train et celui d’une foule distraite par l’arrivée de l’avion, tête en l’air, relâchant son attention aux activités terrestres au point d’en oublier les plus élémentaires précautions.
À rebours de toute définition essentialiste de la vue aérienne, cet ouvrage préconise ainsi une étude historique des pratiques et des médiations du voir, qu’elles soient ancrées dans des lieux élevés ou associées aux machines volantes ayant précédé les développements de l’aviation militaire et commerciale. Au fur et à mesure d’une recherche attentive aussi bien aux paramètres des dispositifs techniques qu’aux singularités des premières réceptions de ces spectacles de la hauteur, Ellis dégage une histoire de la vue à vol d’oiseau fondée sur l’obliquité de la vision définie par des postes d’observation éminents, et sur l’opacité d’images appelant un jeu interprétatif d’allers-retours entre le macroscopique et le télescopique. Défrichant de multiples voies pour de futures investigations, il laisse entrevoir un territoire immense de techniques, de productions et d’usages de la vue d’en haut qui ne sont en définitive pas attachés à des impératifs de surveillance et de contrôle, mais plutôt à des logiques de show, d’attraction et de promotion de la nouveauté. En orientant l’attention vers les « médias lents » (p. 141) et les plaisirs de l’observation, il apporte encore une nuance significative à cette idée, pour nous rappeler que l’attraction ne fut pas faite que de rapidité et de frissons. Il y a donc un monde entre les images obtenues par le photographe et aéronaute Nadar depuis un ballon captif et celles prises par l’astronaute Thomas Pesquet depuis la Station spatiale internationale.
Référence : Stéphane Tralongo, « Patrick Ellis, Aeroscopics. Media of the Bird’s-Eye View, 2021 », Transbordeur. Photographie histoire société, no 6, 2022, pp. 174-175.