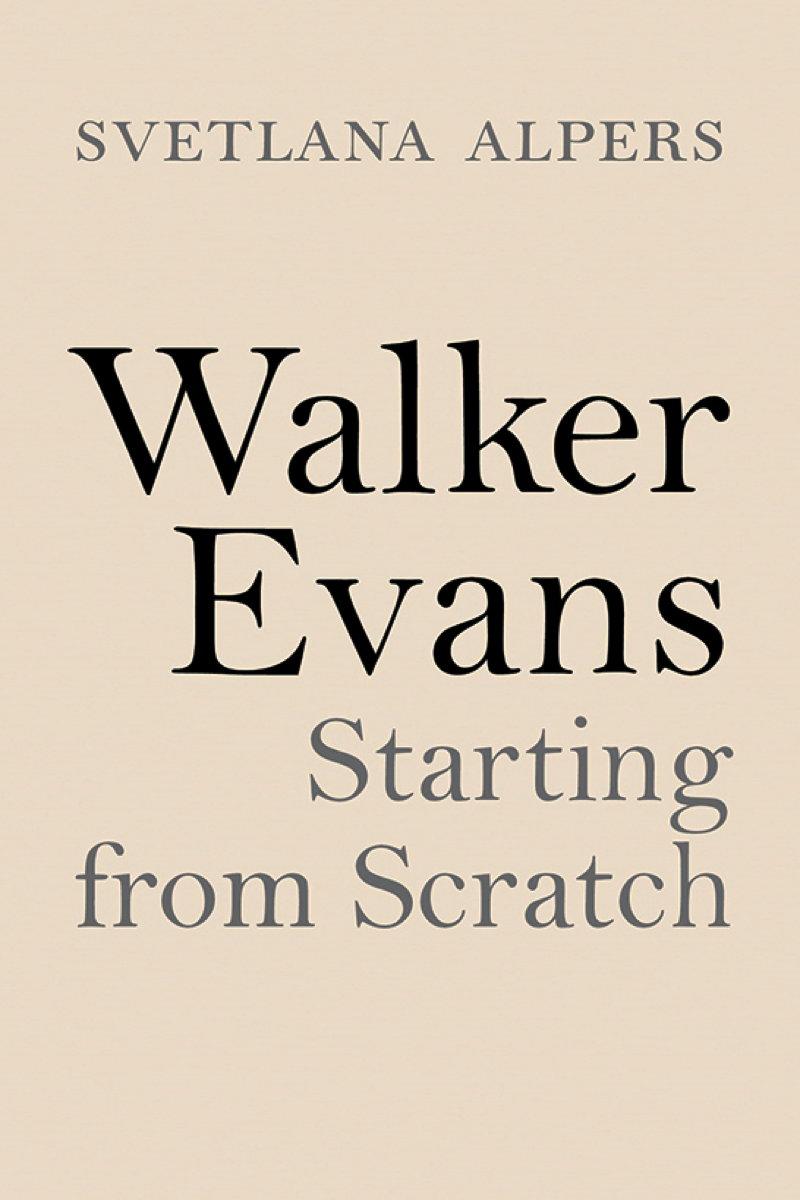
La construction du livre expose le fond et la forme de son argument : il s’ouvre sur un livret iconographique de 145 pages, où chaque image sera convoquée au fil de la démonstration en sept chapitres. Il ne s’agit pas de disserter sur la photographie en général, elle n’existe pas, mais sur celle d’Evans dans le temps long de sa biographie, le livre se déployant ainsi chronologiquement : le séjour français (1926-1927), le retour aux États-Unis et la prise de conscience de « la possibilité du médium », l’expérience cubaine de 1933 (The Crime of Cuba), l’invention de l’Amérique qui culmine dans deux ouvrages clés (American Photographs en 1938 et Let Us Now Praise Famous Men en 1941), les portraits dans le métro (Many Are Called en 1966), l’importance de la carte postale et enfin le polaroïd couleur des dernières années. Svetlana Alpers suit le cheminement d’une oeuvre qui se fait, elle saisit par là-même le faire que l’image photographique engage : « So where do we locate the making? » se demande-t-elle en regardant l’oeuvre d’Evans. S’il s’agissait d’un tableau, la question lui semblerait (presque) simple, car celui-ci possède une matérialité singulière et circonscrite. Concernant la photographie, prise dans la reproductibilité technique, sujette à de multiples interventions (du négatif au tirage, à l’exposition, au livre imprimé), tout semble bien plus incertain.
Chemin faisant, Alpers interroge son propre « making » d’historienne de l’art, elle qui a considéré la peinture d’abord sous ce prisme du faire : L’Art de dépeindre. La peinture hollandaise du XVIIe siècle (1983) et L’Atelier de Rembrandt. La liberté, la peinture et l’argent (1988) ont fait date. C’est pourtant de Tuilages (Roof Life, 2015) que ce livre sur Evans est proche : Tuilages méditait, dans un retour autobiographique, sur le rapport au monde, au-delà de la peinture, d’un oeil historien qui a appris à voir, à créer un regard juste, à bonne distance. C’était en outre une réflexion sur le voir partagé, notamment avec Michael Baxandall : l’injonction « Look! » est le point de rencontre des deux ouvrages. Alpers bascule ici de la peinture hollandaise à la photographie, du XVIIe siècle au XXe siècle, de l’Europe aux États-Unis, poursuivant ce retour réflexif en s’attachant à un objet a priori dissonant avec le champ de ses recherches. Ce pari réussi articule donc le tableau et la photographie, la photographie et les États-Unis : l’oeuvre d’Evans devient la quintessence du médium photographique et le médium lui-même – « un médium américain » selon Alpers. Le sous-titre prend ici tout son sens : Starting from Scratch, partir de rien, inventer un regard photographique « américain » parce que la tradition picturale fait là défaut, lier en quelque sorte la photographie à la frontière, puisque pour Evans comme pour Alpers, on devient Américain dans un détour obligé par l’Europe que l’on rencontre, que l’on quitte et que l’on tient à la juste distance qui lui revient pour pouvoir être Américain. Le livre tisse de subtils échos entre différents types d’écarts propres au regard : distance à soi, distance transatlantique, distance envers l’objet, distance du tableau et de la photographie.
« Yes, it’s the seeing that I am talking about. Oh yes » : cette citation apparemment toute simple d’Evans permet en fait à Alpers de lancer une réflexion profonde et déterminée. La photographie est un oeil plus qu’un appareil, un regard plus qu’un dispositif technique. La photographie s’impose dans son retrait (withdrawal) qui lui permet précisément de procéder « from scratch » : son oeil laisse advenir à la caméra un monde encore hors tradition. C’est un oeil neuf qui se déleste des canons des beaux-arts, du poids du cadre, choisissant la pure présence, assumant la répétitivité de la photographie jusqu’à l’égalisation. Le faire est au service de la chose vue, il s’agit moins de prendre une image que d’avoir un oeil. Convoquant Baxandall, Alpers suggère qu’Evans devient « l’oeil de son temps », car dans le retrait même de l’acte photographique, objet après objet, façade après façade, enseigne après enseigne, portrait après portrait, il travaille l’espace et le temps, il crée une tradition en agençant des éléments au départ insignifiants.
L’esthétique vernaculaire d’Evans invente la forme photographique de l’Amérique : sa patiente collecte, image après image, est à l’Amérique ce que le roman naturaliste est à la France. Le chapitre 1, intitulé « L’oeil d’Evans », raconte comment Evans choisit la photographie en renonçant à l’écriture, devient photographe en devenant flaubertien, ou plutôt en déplaçant Flaubert, ailleurs et en un autre temps, dans l’Amérique du XXe siècle. Lesté d’un appareil et non d’un stylo, Evans, fou de littérature et de poésie françaises, s’efface comme s’efface l’auteur chez Flaubert, gomme la subjectivité et la profondeur, crée une photographie « straight », immobile comme l’est une description interminable d’un roman flaubertien. Alpers montre en quoi Evans crée le style indirect libre en photographie : une présence de l’objet depuis un oeil impersonnel, une densité descriptive sans mots, une causalité de l’objet sans assignation possible. Il invente par là-même un temps : un temps imparfait particulier, où coïncident présent de la description et mise au passé des objets. « Evans was, and is, interested in what any present time will look like as the past » est une citation clé (Evans parle de lui-même à la troisième personne !), tirée de la réédition de American Photographs en 1962 et qui porte tout le livre d’Alpers. Sans nostalgie, ce temps refuse de faire de la photographie une congélation de ce qui a été devant l’appareil, il ouvre au contraire sur la fulgurance de la rue, du détail, de l’insolite, et sur Baudelaire, influence souterraine, mais au moins aussi importante que celle de Flaubert. Evans crée une tension exceptionnelle entre passé et présent, car à chaque présent de l’image le passé est là, non comme ce qui est passé, derrière nous et donc fixé, mais comme passé présent au présent : « the past is related to that present presence » (p. 25). Le détail dit déjà, dans l’instant, le futur du passé et seul un oeil détaché, à distance, peut construire cela.
« La possibilité du médium » photographique, chapitre 2, réside dans ce monde qui est plus vu que contemplé et qui n’a pas encore les mots pour se dire. Evans veut faire des images comme on construit le nouveau monde, construire le monde américain en images photographiques, faire de la photographie contre ou malgré la peinture et son histoire européenne de longue durée. C’est pourquoi la possibilité du médium s’impose une fois revenu et loin de l’Europe. L’urgence du faire rend impossible l’esthétisation, mais impose le détail, la frontalité, le monde à plat. Alpers cite alors Clement Greenberg. Ce dernier affirmait, en qualifiant Evans : « and in more than one way photography is closer today to literature than it is to the other graphic arts », ainsi « let photography be literary »1. La photographie doit être « littéraire », descriptive, narrative car elle n’aura selon lui jamais la réflexivité qu’a le tableau sur son propre médium, son destin est le naturalisme et l’anecdote du fait de sa transparence. Or, la littérarité devient chez Alpers un atout décisif de la photographie d’Evans face au tableau et non un manque propre au médium. Néanmoins, pour que la photographie ne soit pas simplement littérale en étant littéraire, ne soit ni simple document ni trace, il faut lui accorder le pouvoir « de la présence et du possible », un pouvoir de la limite et de la suggestion, et non la cantonner au constat transparent. Alpers déplace alors la citation de Greenberg contre elle-même en prenant acte des ajouts au crayon, que Greenberg voulait donner à sa propre phrase, ici rendus en italiques italiques : « presence or possibility, limit or suggestion, rather than statement, or account or narrative in customary sense. » Le travail de la distance n’est en effet pas la simple transparence.
Le travail du temps se concrétise toujours plus quand Evans s’attache à la vie américaine. American Photographs est pour Alpers un livre sur l’identité américaine, certes, mais un livre où ce qui est donné à voir est la guerre civile, très prégnante dans les images prises au sud des États-Unis. En ce sens, procéder « from scratch » n’est pas un oubli des souffrances de l’Amérique, c’est au contraire une méditation sur sa promesse toujours déjà non tenue (on pense ici à Greil Marcus, L’Amérique et ses prophètes). La photographie est un médium américain, non comme médium d’un monde radicalement neuf, vierge et ouvert au futur (comme par exemple chez Alfred Stieglitz ou Beaumont Newhall), mais au sens d’un passé qui, au présent, n’en finit pas. L’oeil d’Evans capte le vide des plantations et de leurs demeures, les murs, les visages, les minstrels pour exhiber frontalement la violence, restant obsédé par le présent qui a l’air d’être du passé ou devient du passé du simple fait d’être photographié. Evans fait oeuvre de littérature sans mots, racontant la fêlure du temps, imparfait à double titre, grammaticalement et historiquement. Alpers insiste sur la constance d’Evans à faire des photographies pour fabriquer des livres, le roman naturaliste américain exigeant une écriture consciente de son passé, qui sait donc aussi qu’elle se raconte une histoire collective. Le comparant dans de belles pages à Fred Astaire et à Bob Dylan, Evans disparaît selon elle dans sa photographie en cristallisant la réalité américaine, comme Astaire se dissout dans sa danse ou Dylan dans sa musique. Dans la série que produit Evans dans le métro, Alpers souligne là encore le refus de la pose, le besoin de collecter des visages anonymes et de disparaître lui-même dans cette foule. L’écart qui construit le regard conduit l’individu à se placer à la fois au-dedans et au-dehors du collectif.
Evans déplace donc la littérarité du mot à l’image. Alpers ne tranche pas la question de savoir si la photographie relève ou non de l’art, elle s’approprie la formule sibylline du photographe : « it’s an art for all that. » S’il faut maintenir, assure-t-elle, l’idée qu’il n’y a pas d’Art mais des artistes, comme l’affirmait Ernst Gombrich dans sa célèbre Histoire de l’art, l’art de faire de chacun le rend à nul autre semblable. Le « lyrisme documentaire » suffit, conclut le livre, à savoir le monde et lui seul, l’insignifiant magnifié, saisi par un oeil qui est autant enregistreur que lui-même saisi par ce qu’il voit : « I wasn’t looking for anything, things were looking for me », affirme Evans (p. 126), merveilleusement éclairé par Alpers.
Référence : Carole Maigné, « Svetlana Alpers, Walker Evans. Starting from Scratch, 2020 », Transbordeur. Photographie histoire société, no 7, 2023, pp. 188-189.